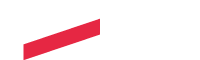- Télécharger en PDF
-
Partager cette page
- Télécharger en PDF
Vous êtes ici :
- Recherche,
[The Conversation] Façonner les cadres, oui, mais à quel point ? Ces team building qui vont trop loin…
Un article écrit par Joan Le Goff, Professeur des universités en sciences de gestion, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC).

le 17 avril 2023
Des cadres supérieurs pris en otage, c’est un fait divers dont on devrait se souvenir. Si celui-ci n’a pas fait la une des journaux, c’est parce que c’était un simulacre, commandité par l’employeur. Pour mieux motiver ses équipes et les mettre à l’épreuve face au stress, il a sollicité une entreprise dirigée par un ancien du GIGN, en vue d’une prestation d’une durée de 2 heures, suivi d’un débriefing sur la motivation.
L’épisode est tellement invraisemblable qu’il inspirera un roman de Pierre Lemaître, Cadres noirs, et la série Dérapages produite par Arte.
Il est, à nos yeux, emblématique de politiques managériales qui, à trop vouloir imprimer des comportements dans les équipes dirigeantes, partent à la dérive. Nous les avons étudiées dans un essai critique récent.
Prise d’otage, licenciement et condamnation
Lors de l’attaque simulée, rien ne s’est passé comme prévu. La violence du raid entraîne des réactions inattendues. La directrice informatique peine à respirer ; deux cadres tentent de s’enfuir et sont rattrapés in extremis ; la directrice commerciale adjointe, claustrophobe, est prise d’une crise de panique et, en état de choc, doit être évacuée en urgence par les assaillants. Les organisateurs décident d’écourter leur mise en scène : le tout ne durera qu’une heure quinze – une éternité quand on est séquestré.
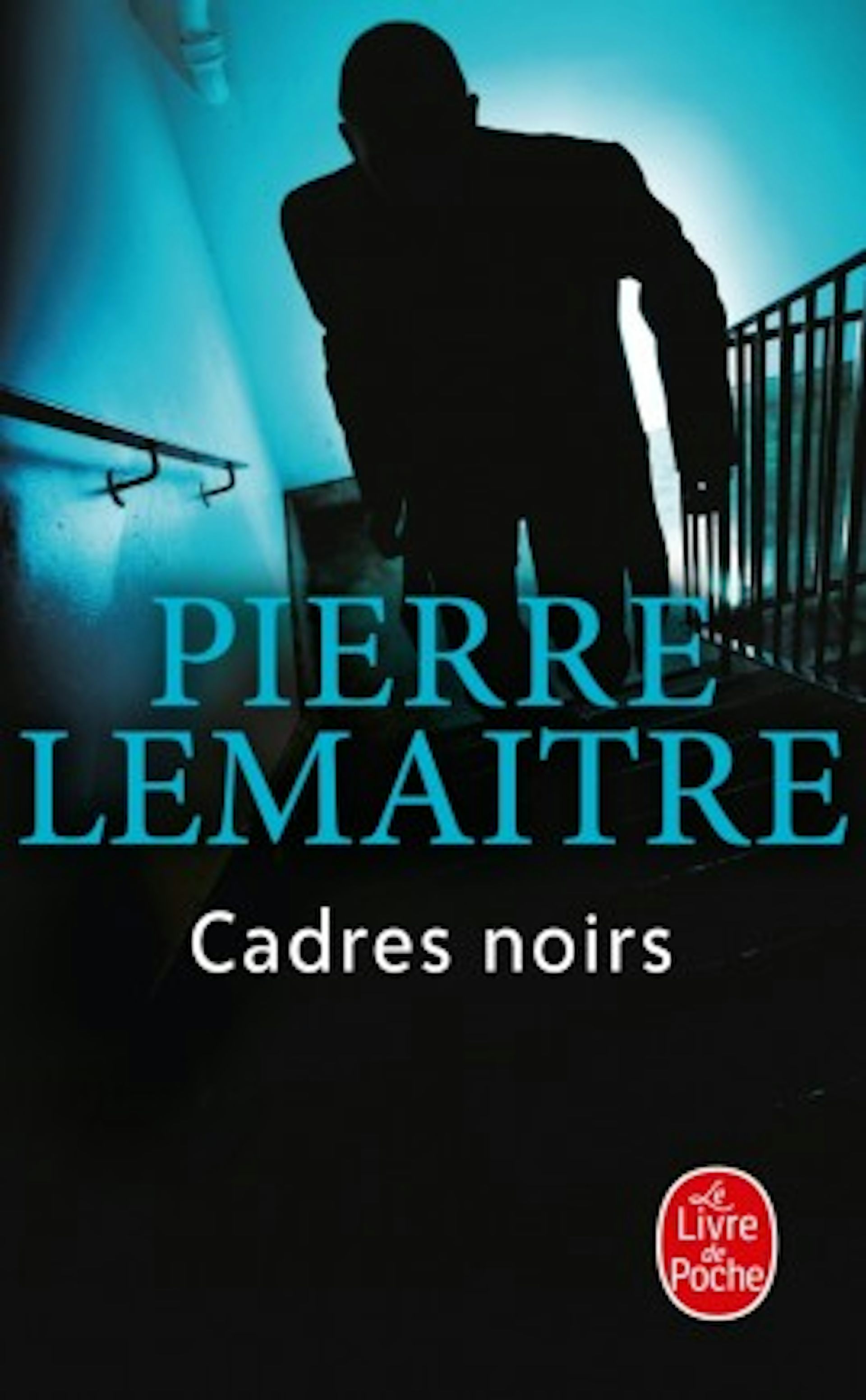
Le lendemain, la suite du séminaire tourne à la débâcle. Certains des membres de la direction ne parviennent pas à faire comme si de rien n’était et à rejoindre leurs collègues en réunion afin d’échanger autour de ce test improbable. À moyen terme, les séquelles psychologiques seront durables chez plusieurs victimes, avec une palette de pathologies allant de l’agressivité, à l’angoisse ou la dépression.
Les conséquences managériales sont plus singulières. L’un des cadres a tenté d’échapper aux ravisseurs et lors du retour d’expérience, cette attitude est stigmatisée tant par le consultant que par sa direction. On lui reproche un comportement « susceptible de mettre en danger la vie d’autrui », ce qui donne lieu à une évaluation négative au regard des attentes de l’employeur. Il sera licencié.
Avant de perdre son emploi, il dépose plainte, considérant que la mascarade organisée par son patron avait un caractère délictueux. Insensible aux arguments du directeur instigateur de l’évènement, qui expliquera que son intention était de créer de l’esprit d’équipe, de souder les cadres, de les rendre résistants à l’adversité – bref, de les soumettre aux objectifs de l’entreprise, pour plus d’efficacité –, la Chambre criminelle de la Cour de cassation l’a condamné le 7 avril 2010 pour « complicité de violences aggravées, avec préméditation et usage ou menace d’une arme », un chef d’accusation plutôt rare pour un dirigeant d’entreprise.
Rendre les cadres dociles
Modeler les comportements des cadres répond, certes, à des impératifs vitaux pour les entreprises : convaincre de la qualité de la prestation en effaçant l’individu derrière la marque, limiter la dépendance envers un manager en le rendant remplaçable à tout moment, et, surtout, éviter les risques juridiques en renforçant la loyauté pour décourager dénonciations ou trahisons, sachant que certaines pratiques lucratives doivent absolument demeurer cachées sous peine de donner lieu à des sanctions financières élevées. L’environnement hypercompétitif a fait du franchissement de la légalité une arme comme une autre pour s’imposer sur les marchés (entente, espionnage industriel, etc.) et, dans ce contexte, s’assurer du dévouement des équipes est vital.
 Cette docilité des effectifs s’obtient notamment grâce à la prolifération de normes comportementales dans l’environnement professionnel. Elles visent à dicter les agissements des individus dans et hors des organisations et se distinguent des autres familles de normes managériales, les normes techniques (qui portent sur les process) et les normes de performance (pour les objectifs).
Cette docilité des effectifs s’obtient notamment grâce à la prolifération de normes comportementales dans l’environnement professionnel. Elles visent à dicter les agissements des individus dans et hors des organisations et se distinguent des autres familles de normes managériales, les normes techniques (qui portent sur les process) et les normes de performance (pour les objectifs).
Surabondantes, ces injonctions sont largement contradictoires. C’est en fait un élément constitutif de la domination. Par exemple, si les entreprises ont été militantes du rangement des bureaux, elles sont devenues tout aussi vite adeptes du désordre et de ses bénéfices présumés, comme la créativité. Peu importe ce qui est juste car, dans les deux cas, au sein d’un open space, celui qui est à contretemps est repérable sans mal : son bureau est en pagaille quand ceux de ses collègues sont vides ; sa table est nette, quand le rangement est perçu comme une perte de temps. Pour l’employeur, il sera justifié de se séparer d’un élément visiblement si peu intégré à l’équipe…
Toutes ces normes reposent sur un fonctionnement identique : la mise en rapport d’un système de valeurs et d’un ensemble de savoirs subjectifs pseudoscientifiques. Il en résulte des énoncés, souvent formalisés, dont le contenu importe moins que la portée. Ce qui compte, c’est l’obéissance, pas ce à quoi on obéit. Le modelage des personnes via les process, les objectifs et les conduites devient une condition de la performance collective.
Se plier ou se faire virer ?
Comment y parvenir ? Le premier public visé au moment de la formalisation de la gestion, à la fin du XIXe siècle, avait été les ouvriers et les employés. Port de l’uniforme, adoption de rituels obligatoires, recours à un vocabulaire spécifique, les outils mobilisés ont été nombreux.
Pour les cadres aussi, l’apparence vestimentaire constitue une première étape, avec des dress code parfois très élaborés qui se trouvent renforcés par les effets du mimétisme, étonnamment rapide dans les sièges sociaux.
Les formations pour cadres et dirigeants constituent un autre levier. Elles portent de moins en moins sur les connaissances managériales stricto sensu et se focalisent sur les comportements, lors de classiques séminaires de communication ou d’autres, moins orthodoxes : pratiques artistiques (théâtre, cirque, slam…), conférences culturelles (philosophie, littérature…), activités sportives (voile, rugby…) ou « learning expeditions » (immersion en terrain insolite : pays étranger, ONG, ferme, tournoi de poker, stages commandos). Cet inventaire paraît surréaliste. Ce qui est sûr, c’est que ne pas se plier à l’animation proposée est synonyme d’éjection rapide du collectif et, donc, de son poste.
Des simulacres qui peuvent aller très (trop ?) loin
Des entreprises sont parfois passées à un niveau supérieur, couplant surprise et réalisme. C’est le cas de celle dont nous avons narré les péripéties, parmi d’autres. Ainsi, le même artifice aura lieu en juin 2018, au siège parisien de Publicis.
En sortant de son bureau, un employé croise un homme patibulaire, vêtu d’un treillis et armé d’une kalachnikov – la barbe est réelle, l’arme est factice.
[The Conversation lance Entreprise(s), sa nouvelle newsletter hebdomadaire dans laquelle nos experts présentent les clefs de la recherche pour la vie profesionnelle. Abonnez-vous aujourd’hui]
Or, le fait divers est toujours la confluence des chances et des malchances, des aléas et de l’improbable : le 13 novembre 2015, ce cadre, sa femme et leurs amis assistaient au concert du Bataclan quand la fusillade mortelle s’est déclenchée. L’agence publicitaire ne pouvait l’ignorer : deux de ses employés figurent parmi les victimes du massacre. La rencontre fortuite dans les couloirs feutrés entre le rescapé d’un carnage et un assaillant menaçant ne pouvait que déclencher un séisme psychologique (crises d’angoisse, insomnies, etc.) et mener l’employeur devant le conseil des prud’hommes, qui donnera raison à l’employé par un jugement en date du 21 janvier 2020.
Pour ces simulacres, le principe est la mise en place d’un scénario catastrophe qui prend les cadres au dépourvu et les met à l’épreuve : (fausse) découverte de prion dans des yaourts d’un leader français ; train en (fausse) panne en rase campagne, la nuit ; (faux) blessé lors d’une réunion, à soigner ou évacuer… Tous ces exemples incongrus sont réels. On en arrive à des situations extrêmes, qui finissent non pas dans les manuels de management mais dans la rubrique des faits divers.![]()
Joan Le Goff, Professeur des universités en sciences de gestion, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
- Télécharger en PDF
-
Partager cette page
- Télécharger en PDF